Le point Darwin
- Caterina Zomer
- 24 nov. 2025
- 11 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 nov. 2025

Darwin au goût du jour. Illustration Paul Spella, The Atlantic, 18 février 2021
Le 24 novembre 1859, un livre fit vaciller un monde sûr de ses certitudes : avec L’Origine des espèces, Darwin jetait un pavé scientifique dans le lac tranquille du créationnisme. Entre éclats de scandale, batailles d’idées et héritages encore brûlants, retour sur la secousse qui a redéfini notre place dans le vivant. 366 ans plus tard, Donald Trump et certains de ses soutiens n'ont toujours pas compris Darwin...
J-37 : DONS DÉFISCALISABLES JUSQU'AU 31/12/2025
Compte à rebours : Il nous reste 37 jours pour espérer réunir d'ici le 31 décembre entre 3.500 € et 4.000 €, de façon a améliorer le site et son référencement et pouvoir salarier un.e premier.e journaliste, conditions exigées pour pouvoir espérer (enfin !) de possibles aides publiques en 2026. Depuis le lancement de cette campagne (le 31 octobre), dix-sept donateurs, 1.515 € (compteur bloqué depuis le 19 novembre).
Pour mémoire, nous avons fait le choix d'un site entièrement gratuit, sans publicité, qui ne dépend que de l'engagement de nos lecteurs. Jusqu'au 31/12/2025, les dons sont défiscalisables (à hauteur de 66% du montant du don). Un don de 25 € ne revient ainsi qu'à 8,50 € (17 € pour un don de 50 €, 34 € pour un don de 100 €, 85 € pour un don de 250 €). Dons ou abonnements ICI
LES CITATIONS DU JOUR
« Il n'y a pas de religion sans amour, et les gens pourront parler autant qu'ils le voudront de leur religion, s'ils n'apprennent pas à être aussi bons avec les animaux qu'avec les humains, c'est une imposture. » (Anna Sewell, "Black Beauty")

Il y a 148 ans, le 24 novembre 1877, paraissait Black Beauty (en français, parfois intitulé Beauté noire ou Prince noir), l’unique roman d'Anna Sewell, écrit entre 1871 et 1877 alors qu'elle était souvent malade et incapable de marcher sans béquilles à cause d'une blessure à la cheville survenue dans son enfance. Le roman raconte l'autobiographie fictive d'un cheval nommé Black Beauty, qui vit diverses mésaventures liées à la cruauté ou à la compassion des humains dans l'Angleterre du XIXe siècle. Chaque chapitre contient une leçon ou une morale sur le traitement des chevaux à cette époque. L'œuvre, très en avance sur son temps concernant la protection animale, dénonce notamment l'usage de pratiques cruelles comme la fausse rêne et les œillères. Anna Sewell a commencé à s'intéresser aux chevaux très tôt, notamment parce qu'elle se déplaçait en calèche suite à son handicap, développant ainsi une profonde affection pour ces animaux. Son roman, initialement destiné aux personnes travaillant avec les chevaux, est devenu un best-seller. Elle est décédée cinq mois seulement après la publication de Black Beauty.
« Il faut montrer la vie et combattre la mort. » (Albert Libertad)

Né à Bordeaux il y a tout juste cent cinquante ans, le 24 novembre 1875, Albert Libertad était un militant anarchiste, connu pour avoir fondé le journal L'Anarchie, un organe important de la pensée anarchiste de son époque. Malgré un handicap qui le contraignait à se déplacer avec des béquilles, il fut très actif dans la promotion des idées anarchistes à travers des réunions publiques, des écrits et une intense activité militante. Libertad a également été l'un des fondateurs de la Ligue antimilitariste en 1902 et a participé au mouvement anarchiste montmartrois. Il défendait une révolte qui s'exprimait non pas hors de la société mais à l'intérieur, cherchant à transformer radicalement la société avec un fort penchant pour l'émancipation individuelle et collective. Il se voulait aussi proche du communisme libertaire, insistant sur la camaraderie contre la concurrence bourgeoise. Il est mort en novembre 1908 à la suite d'une infection après une bagarre liée à son activisme.
« Ils ne savent pas que le rêve est une constante de la vie, que toujours que l’homme rêve, le monde saute et avance comme une balle colorée dans les mains d’un enfant. » (António Gedeão, "Pedra Filosofal" / Pierre Philosophale)

Né à Lisbonne il y a cent dix-neuf ans, le 24 novembre 1906, António Gedeão, pseudonyme de Rómulo Vasco da Gama de Carvalho, est un poète, chimiste et professeur portugais célèbre pour sa poésie engagée, mêlant science et humanisme. António Gedeão fut une figure majeure de la littérature portugaise contemporaine. Il a commencé à publier ses poèmes vers la cinquantaine, mêlant souvent poésie, science et humanisme, avec une sensibilité à la réalité de son époque et aux interrogations de l'après-guerre. Son œuvre poétique est appréciée pour sa capacité à allier rigueur scientifique et pensée poétique. Le 24 novembre, jour de sa naissance, est commémoré au Portugal comme le Jour national de la Culture scientifique (Dia Nacional da Cultura Científica).
ÉPHÉMÉRIDE
(R)évolution
Au commencement était le Verbe.
Jusqu’à ce que la science ne vienne mettre son grain de sel.

Il y a tout juste trois cent-soixante-six-ans, le 24 novembre 1859, paraissait à Londres chez l’éditeur John Murrey, la première édition de l’œuvre fondatrice du naturaliste anglais, On the Origin of Species (titre complet : On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life). La théorie de l’évolution par sélection naturelle était ainsi posée, après avoir mijoté pendant vingt ans dans la tête fervente d’un jeune gentleman victorien aux sens vifs et à l’esprit d’observation suraigu. Tiré à 1.250 exemplaires, il paraît que le livre fut épuisé le jour même. Six autres éditions suivront du vivant de l’auteur, chacune révisée et mise à jour, si bien que la dernière, datée de 1872, est souvent considérée comme la version la plus accomplie et définitive de la théorie évolutionniste. Mais l’édition « augmentée », comme on dirait de nos jours, n’eut point les effets de son aînée, laquelle fit le bruit éclaboussant d’un gros rocher tombant de très haut sur la surface d’un lac jusque-là imperturbable.
Cet imperturbable lac, c'était la théorie créationniste, à laquelle s’étaient globalement rangées les sciences naturelles du XVIIIe siècle quant à l’origine de la vie, enrichie au XIXe siècle par son corollaire le fixisme, soit l’idée que tout ce qui existe est directement sorti, tel quel, des mains de Dieu. Si l'on parle de "création", c'est bien qu'il fallut un Créateur, circulez, braves gens, et priez pour le salut de vos âmes... La nature et tous ceux qui y vivent, y inclus animaux et aussi certains humains sauvages et primitifs, sont le cadeau miraculeux, et immuable, que Dieu a fait aux hommes. On caricature à peine, et souvenons-nous qu’à la même époque paraissaient aussi les premières formulations modernes de la théorie de la race, dont on ne ne sait que trop ce qu'allait en faire le XXe siècle... Quoi qu’il en soit, c’est dans ce bouillon de culture que fut éduqué le jeune Darwin, avant de se sentir un peu à l'étroit dans les alcôves de la bienséance intellectuelle victorienne.

Shrewsbury, Pride Hill, autour de 1880. Photo Francis Bedford / Albumen print.Collection, National Media Museum Collection (Angleterre)
Né en 1809 d’un père médecin et une mère issue d’une famille abolitionniste, coaché par un grand-père paternel nommé Erasmus, physicien excentrique et poète, Charles Darwin fréquente entre 1818 et 1825 l’école anglicane de Shrewsbury, sa ville natale dans le Shropshire. La science y est estimée immorale car relativiste, qui à l’époque en anglais se dit "déshumanisante". Le petit se ramasse des punitions, à force de s’amuser avec les alambics de la salle de chimie, matière dans laquelle il est si versé que ses copains se moquent de lui en lui affublant le sobriquet de « Gaz ». Résultat : ce n’est pas un élève stupéfiant, et il déteste aller s’instruire. À 16 ans, son père l’expédie étudier la médecine à l’université d’Edimbourg, à l’époque le top du top pour des études supérieures en Angleterre. Le nouveau décor lui sied beaucoup mieux, surtout que le jeune Darwin peut y étudier de tout... sauf la médecine. D’ailleurs, il ne tolère pas les cours d’anatomie et les travaux dirigés de chirurgie lui donnent une forte envie de vomir. Ce qu’il kiffe, ce sont la géologie et la botanique, et surtout les séances de cours informels que lui dispense John Edmonstone, un ancien esclave américain au musée d’Edimbourg, qui lui apprendra la classification des oiseux, les stratifications rocheuses et les merveilles de la flore et de la faune coloniales.
Mais ce qui plus compte pour la suite, c’est qu’en ces années-là l’université d’Edimbourg est devenue le repaire de jeunes de bonne famille issus du mouvement des Dissenters - un courant de la culture protestante dont les membres refusent de se conformer aux dogmes de l’Église d’Angleterre - et pour lesquels converger à Edimbourg est une question de force majeure, car Cambridge et Oxford refusent de les diplômer. Dans les réunions des associations étudiantes, le jeune Charles écoute ces fous dire d’un rire moquer que Dieu n’a rien à voir avec l’anatomie humaine, que les quadrupèdes pensent tout autant que les bipèdes, et que l’esprit est fait de matière grise - discours subversif au plus haut point, que les autorités universitaires censurent aussitôt. L’un de ses plus grands amis est Robert Edmund Grant, fan de Jean-Baptiste Lamarck, le naturaliste français qui avait déjà imaginé que la vie évolue, dans son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, paru en 1815. Les deux se promènent sur la plage pour recueillir des coquillages et autres spécimens marins, le jeune Grant expliquant au jeune Darwin comment il s’est persuadé, bien avant Lovecraft, que tout vient de la mer et de ces invertébrés capables d’évoluer vers des organismes bien plus complexes. Balades dangereuses. Le père de Darwin, qui a du pif, subodore l’hérésie et inquiet que son fils ne dévie du droit chemin, le fait transférer séance tenante au Christ’s College à Cambridge, où Charles arrive en 1828, tout ébouriffé de brise saline, d'éponges et d'idées "pas très catholiques".
De droite à gauche : le révérend Adam Sedgwick (gravure, 1857) et
Alexander von Humboldt, huile sur toile, Julius Schrader, 1859, Metropolitan Museum of Art, New York City)
Ce n’est pas du tout Edimbourg. Charles Darwin apprend une version bien conservatrice de la botanique par le révérend John Stevens Henslow et suit les cours de « Desseins providentiels dans le monde animal » dispensés par le révérend Adam Sedgwick. Il va à cheval et à la chasse, sirote des spiritueux, s’habille en redingote et fréquente la bonne société anglicane. Des traces restent du naturaliste séditieux qu’il menaçait de devenir dans le fait qu’il collectionne des cafards, mais dans l’ensemble on dirait qu’il commence à rentrer dans le rang. Son père vient à peine de se détendre que son fils se prend encore une fois les pieds dans le sillon d’un autre mauvais maître, l’explorateur et naturaliste allemand Alexander von Humboldt, dont il lit le Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, publié en 1805. Charles ressent l’appel du large, et le 27 décembre 1831, il embarque sur le HMS Beagle du capitaine de la Royal Navy Robert Fitzroy, faisant cap sur la Patagonie.
La suite est une connue. L’expédition du capitaine Fitzroy était surtout centrée sur la cartographie des côtes sud-américaines, mais en tant que gentleman naturaliste, Darwin put passer beaucoup de temps à terre pour vaquer à ses observations de terrain et ramasser par terre tout en n’importe quoi, pourvu que ça serve à comprendre dans quel monde on vit. En réalité, lors ce voyage de cinq ans, il ne passa que 18 mois sur le bateau, ce qui ne fut d'ailleurs pas pour lui nuire, vu qu'il souffrait horriblement de mal de mer. Dans sa circumnavigation de l’Amérique du Sud, Darwin put faire l’observation directe de la richesse époustouflante de la vie, y compris celle de la Terre elle-même, sous toutes ses formes, du plancton et des moules accrochées aux rochers dans le vaste océan aux sommets vertigineux des chaînes andines, en passant par la magnificence de la forêt pluviale, les fossiles émergeant de la poussière, les araignées grouillant aux pieds des arbres, les indigènes de la Terre du Feu, les volcans, les tortues, les iguanes et bien évidemment les fameux pinsons des Galapagos, dont la légende veut que le bec l’intrigue définitivement. On dit en effet que ce fut en remarquant les légères différences entre les oiseaux de la même famille vivant sur des îles différentes de l’archipel que Darwin eut la fulgurante intuition de l’évolution et de la sélection naturelle. En réalité, l’idée mettra encore beaucoup de temps à mûrir. C’est qui est certain est que, lorsque le HMS Beagle toucha les côtes anglaises en octobre 1836, en descendit une tout autre personne que celle qui y était montée, armée de 1.750 pages de notes, 12 catalogues et 5.436 peaux, os et carcasses en tout genre, ayant à l’esprit une seule et unique question : qu’est-ce qui explique une telle prodigalité de la nature ? C’est bien à cette personne-là que l’on doit les travaux qui allaient changer à jamais la science, et le rapport qu’avec elle entretenait l’autre grand point de repère qui voulait orienter les humains dans le vaste monde, à savoir la religion.

Le Premier Jour de la création, Chronique de Nuremberg, 1493
La publication du livre de Darwin donna lieu à des réactions virulentes dans les milieux créationnistes, qui y virent une remise en cause blasphématoire du dogme de l’origine divine du monde. Que les hommes et les animaux puissent avoir des ancêtres en commun et que les différences entre les humains dépendent des latitudes et non pas de la malédiction de Cham était un discours que les puritains ne pouvaient tout simplement pas entendre. On ne savait pas ce qui était pire, si l’idée qui y était implicite que les hommes ne sont guère faits par la volonté de Dieu pour régner sur les êtres inférieurs, fussent-ils leurs semblables, ou l’idée qu’elle semblait suggérer que la vie peut parfaitement se suffire à elle-même, sans besoin d’aller chercher une causa prima extérieure qui l’aurait mise en branle. « Descendez-vous du singe par votre père ou par votre mère ? » lançait sardonique Samuel Wilberforce, évêque d’Oxford, à Thomas Henry Huxley, botaniste, paléontologue et ardent défenseur de la thèse évolutionniste - à un tel point que les détracteurs le surnommèrent « le bulldog de Darwin » -, lors d’un célèbre débat qui se tint le 30 juin 1860 au musée d’histoire naturelle de l’université d’Oxford.
C’est clair : la Terre a 2025 ans et elle a été faite en six jours. Peut-être que Dieu n’avait pas encore vu venir Trump et les fondamentalistes religieux du MAGA, mais les tenants du créationnisme ne disparurent pas après 1860 et la fameuse boutade de l’évêque d’Oxford est encore aujourd’hui d’actualité, notamment aux États-Unis. Ces irréductibles ne veulent surtout pas descendre des singes, à en juger du fameux procès Scopes, en 1925, qui se termina par la condamnation de John Thomas Scopes, un professeur de sciences naturelles du Tennessee, accusé d’avoir enseigné la théorie de l’évolution de Darwin en violation du Butler Act, une loi locale qui interdisait l’enseignement de toute théorie niant la création divine selon la Bible. Rappelons en passant que bien que le créationnisme ait vu le jour dans les milieux protestants, le catholicisme ne s’est pas montré beaucoup plus "moderne" : il fallut attendre 1990 pour que le Vatican laisse enfin tomber la condamnation de la théorie de l’évolution, proscrite en 1961 en tant que dangereuse et mensongère. Au Tennessee, le Butler Act resta en vigueur jusqu’en 1967, mais le procès Scopes eut un impact durable sur la manière dont l’évolution est enseignée aux États-Unis, surtout dans les États de la Bible Belt, dans le sud, terre conservatrice et rigoriste où le créationnisme est particulièrement enraciné, et où aujourd’hui il prend les nuances d’un « dessein intelligent ».

"L'évolution est un conte de fées pour adultes" : la voiture d'un créationniste sur Broad Street, à Athens (Georgia), en 2006
En se parant d’une allure pseudo-scientifique, le mouvement du dessein intelligent (ou « intelligent design ») est une forme moderne du créationnisme qui affirme que certaines caractéristiques complexes et spécifiques de l’univers et du vivant ne peuvent pas être expliquées par des processus naturels non dirigés, comme la sélection naturelle darwinienne. La vie, et les créationnistes eux-mêmes, il faut croire, sont tout simplement trop merveilleux pour ne pas penser qu’ils ont été créés par une intelligence supérieure, Dieu ou Chat GPT, au choix. Aujourd’hui, cette théorie est surtout prônée par le Discovery Institut, un think tank conservateur chrétien fondé en 1991 à Seattle. Un document diffusé cet institut, connu sous le nom de Wedge Document, définit une "stratégie de combat" en trois étapes : « Premièrement la recherche scientifique et la publication, ensuite la formation de l’opinion publique, et enfin une confrontation culturelle visant le renouveau des valeurs théistes dans la société ».
Il en faudra sans doute un peu plus pour éradiquer le matérialisme dans lequel le monde n’arrête pas de sombrer depuis ce jour lointain de 1859...
Caterina Zomer





.png)






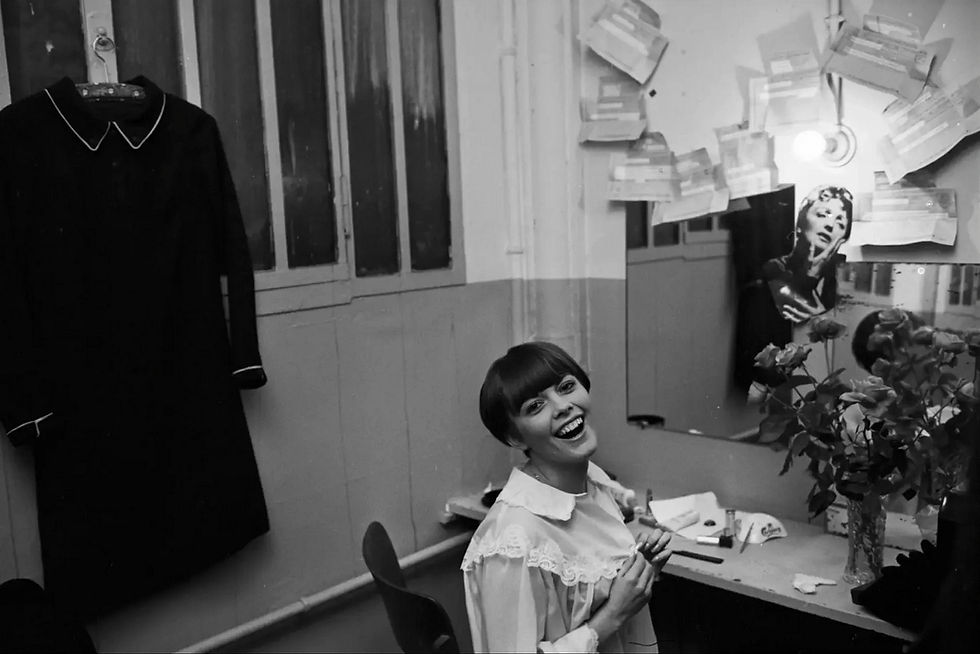
Commentaires